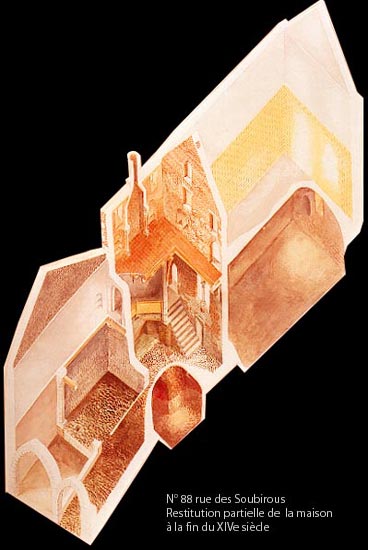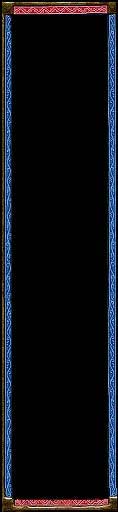
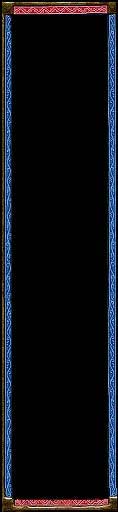
Les circulations secondaires : les galeries
Pour accéder aux étages supérieurs ou aux autres bâtiments
disposés autour de la cour, on trouvait des circulations secondaires
telles que des galeries ou des échelles en bois. On appelle parfois
ces cours des cours distributives, car elles concentrent l’essentiel
de la distribution et donc de la circulation entre les pièces des différents
corps de bâtiment. La demeure des XIIe-XIVe siècles ne connaît
en effet ni le couloir de distribution ni la circulation verticale continue
qui caractérise au contraire les maisons des XVe-XVIe siècles,
où l’escalier en vis monte depuis le sous-sol jusqu'au dernier
étage.
Certaines de ces circulations secondaires ont survécu en étant
remaniées ou reconstruites comme au n°
75 rue du Maréchal-Joffre [notice],
mais la plupart, moins durables que les escaliers maçonnés,
ont disparu. Néanmoins, l'observation des cours et l'analyse des traces
d'anciennes ouvertures nous permettent souvent de les restituer.
Un exemple de ces structures disparues mais restituables se trouvait dans
la cour
d'entrée de l'hôtel de la rue de Lastié [notice].
Diverses traces dans les murs médiévaux permettent d’imaginer
une galerie aérienne en bois partant du premier étage et longeant
le mur ouest de l'hôtel en couvrant la première volée
du grand degré. Dans l'hypothèse proposée, elle est portée
par un poteau, également en bois, placé au départ de
l'escalier maçonné.
La restitution du N°
35 rue de Lastié [notice]
nous montre une demeure à deux corps de bâtiment, le premier
sur rue et le second en fond de parcelle, séparés par une cour.
Cette dernière était divisée en deux par un très
haut mur-écran disposé dans le sens de la profondeur de la parcelle.
Le grand degré en maçonnerie était vraisemblablement
remplacé ici par un escalier en charpente. Le dessin ci-contre nous
montre la disposition des galeries qui reliaient, à chaque étage,
les deux bâtiments. Celles qui s’appuyaient contre le mur-écran
desservaient en même temps des latrines
aménagées avec leurs conduits d'écoulement dans l’épaisseur
du mur.
La plupart du temps elles assuraient la liaison entre les différents
corps de bâtiment d'une propriété mais, nous venons de
le voir, elles pouvaient aussi contenir des latrines. Au N°
88 rue des Soubirous [notice],
la galerie en permet aucune communication entre les deux corps de bâtiment,
mais elle accueille une cuisine équipée d’un placard,
d’une cheminée et d’un évier.
Les escaliers en bois
Les escaliers secondaires étaient sans aucun doute nombreux car ils
s’imposaient dès que la maison avait plus d’un étage.
C’est souvent la trace oblique du limon sur l’enduit d’un
mur qui nous en garde aujourd’hui le souvenir. L’un de ces escaliers
en bois a pu être restitué avec certitude au 42
rue de la Daurade [notice],
où l'échelle de meunier menant à la chambre du deuxième
étage de la tour était placée dans la cuisine, elle-même
accessible seulement à partir de l'aula.
L’étude des vestiges de l’un des grands édifices
médiévaux de Cahors le palais
Duèze [notice].
nous permet de restituer une structure plus rare, celle d’un escalier
extérieur accroché à la façade de la tour, semblable
à ceux que représentent des peintures italiennes du XIVe siècle.
La tour, qui s’élève à l’articulation des
ailes nord et ouest, comporte en effet une porte haute auprès de laquelle
subsistent des trous de fixation disposés en oblique qui pourraient
correspondre à un escalier en bois, peut-être couvert. Celui-ci
partait du comble de l’aile ouest, plus large que la tour elle-même
car sans doute entièrement doublée par des galeries (qui ne
sont pas représentées sur le dessin ci-contre).